“Le changement global de l’environnement est sans doute le plus urgent des problèmes internationaux du prochain siècle.” L’Académie des sciences américaine, associée à celle des sciences de l’ingénieur et à celle de médecine, conclut ainsi l’introduction de leur rapport commun One earth, one future. Depuis la conférence de Rio, on range sous la rubrique du changement global trois éléments qui affectent l’ensemble de la planète : le réchauffement dû à l’effet de serre (global warming), la biodiversité, c’est-à-dire le risque de disparition d’espèces animales et végétales, et le trou dans la couche d’ozone. Ce dernier a pris une dimension emblématique, car son existence et son mécanisme de production paraissent fournir le premier exemple d’un changement à l’échelle planétaire dont l’homme serait responsable.
Un article de J. Farman dans la revue scientifique Nature en 1985 a révélé que la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique avait perdu 40 % de son épaisseur entre 1977 et 1984. L’annonce suscita aussitôt des réactions passionnées, les uns estimant qu’il s’agissait d’une fluctuation naturelle ayant déjà existé dans le passé, mais qui n’avait jamais été mesurée, les autres pensant tenir la première preuve de l’action de l’homme sur la biosphère. Pour trancher, on multiplia les observations et on réexploita des données plus anciennes, notamment celles du satellite Nimbus 7 que la NASA avait mis en orbite en 1978. Les résultats confirmèrent ceux de l’article de Farman, et même les amplifièrent. Si l’on regarde par exemple les mesures d’ozone faites au-dessus de la base de Halley, non loin de la terre Adélie, à chaque début de mois d’octobre depuis 1955, on constate que l’épaisseur moyenne de 300 unités avant 1975 descend ensuite très vite pour atteindre 180 unités en 1985.
Comment expliquer cette tendance qui s’est confirmée en 1987 et 1989? Très vite on a soupçonné que les atomes libres de chlore et de brome qui flottaient à l’altitude de l’ozone étaient en partie responsables de la raréfaction constatée. Le mécanisme semble maintenant bien compris : la couche d’ozone se trouve dans la stratosphère. N’imaginons pas qu’elle forme une coquille dense. Dans l’atmosphère raréfiée des grandes altitudes, elle ne représente que quelques molécules sur un million, dix au plus à 35 km d’altitude, où elle est la plus dense. Cependant, la superposition de particules rares sur une profondeur de 50 km finit par constituer un bouclier qui intercepte la plupart des ondes ultraviolettes émises par le soleil, qui sont dangereuses pour la vie.
Avant 1975, l’ozone suivait un cycle à peu près équilibré : il se formait en haute atmosphère lorsque des molécules habituelles d’oxygène (O2) étaient brisées par le rayonnement solaire en leurs deux atomes constituants qui ensuite se recombinaient à une molécule intacte pour former l’ozone (O2 + O = O3). Cette nouvelle molécule assez fragile est ensuite détruite tôt ou tard par divers corps chimiques, dont les atomes libres de chlore et de brome sont les plus virulents. Cela se passe à peu près ainsi : le chlore Cl casse l’ozone en une molécule habituelle d’oxygène O2 et un atome d’oxygène avec lequel il forme de l’oxyde de chlore (ClO). Instable, ce dernier se dissocie rapidement, libérant l’atome de chlore pour une nouvelle attaque de l’ozone. En un jour, un seul atome de chlore peut détruire ainsi plusieurs milliers de molécules d’ozone.
Pour que ce mécanisme de destruction fonctionne, certaines conditions précises doivent cependant être réunies, sans quoi il n’y aurait plus d’ozone depuis belle lurette. D’abord, du chlore doit monter dans la stratosphère. Il provient des océans pour une petite part, mais il est surtout véhiculé par les composants bromés et chlorés de l’industrie, les célèbres CFC, ou halocarbones, utilisés pour leur stabilité chimique et thermique comme refroidissants dans les réfrigérateurs, comme produits de lutte contre l’incendie et dans de multiples procédés de pulvérisation sous pression. On se demandait où les CFC disparaissaient après usage, puisqu’ils ne pouvaient pas être détruits dans les conditions ambiantes à la surface terrestre. En fait, entraînés par la circulation atmosphérique, ils s’éparpillent dans toute la stratosphère. Certaines molécules d’halogène finissent par s’échapper de la terre en altitude, mais d’autres participent à un cycle chimique au-dessus du pôle Sud.
En effet, une partie de l’atmosphère qui surplombe l’Antarctique est prise au piège pendant plusieurs mois. Elle tourne en rond dans ce que l’on nomme le “vortex polaire sud” et se refroidit de plus en plus. Quand elle descend au-dessous de -80°C, des cristaux de glace apparaissent en légers nuages. Ils offrent une surface de contact aux CFC, qui viennent s’y décomposer, et libèrent après réaction avec de l’acide chlorhydrique des molécules de chlore (Cl2) rapidement dissociées par le rayonnement solaire. C’est alors que la chasse à l’ozone par les atomes libres de chlore commence. Si j’insiste un peu sur le mécanisme chimique, c’est qu’il est assez facile à comprendre et pourrait être enseigné au lycée après un ou deux ans de chimie avec ses classiques HCl, O2 ou ClO. Mais surtout, il permet d’apprécier les concours de circonstances qui entraînent la réaction globale, et donc mieux jauger son développement futur.
Des conditions très différentes doivent, comme on le voit, être réunies simultanément pour que l’ozone soit attaqué par le chlore et le brome :
– Des CFC doivent être émis par l’industrie.
– L’atmosphère doit être refroidie en dessous de -80°C, ce qui n’est possible que dans un vortex où l’air stagne au voisinage du pôle jusqu’à créer des nuages de cristaux.
– Le rayonnement solaire doit dissocier les molécules de chlore (Cl2).
Ces conditions ne se rencontrent pratiquement qu’au pôle Sud pendant une courte période, en octobre : le vortex est créé au pôle Sud par l’hiver austral qui a refroidi au-dessous de -80°C l’atmosphère en altitude. Le soleil réapparaît avec le printemps austral. Il brise les molécules de chlore qui étaient restées stables dans la nuit polaire, mais, en même temps, il élève la température, fait fondre les nuages de cristaux et interrompt la décomposition des CFC. Peu après, le vortex se défait à cause du réchauffement qui dilate l’air, et les atomes qui ont vécu cette aventure sont dispersés tout autour du globe par le rétablissement de la circulation atmosphérique. Que l’une de ces conditions manque, et le mécanisme s’arrête. Ainsi, à la suite d’un hiver plus chaud en 1988, le trou d’ozone ne put se former car le soleil était revenu avant que le froid stratosphérique ne soit devenu suffisamment intense. C’est aussi en raison de ces conditions que le trou est moins important au pôle Nord : l’absence d’un continent très froid comme l’Antarctique limite le vortex et le refroidissement. L’ampleur du trou dépend alors étroitement de la sévérité de l’hiver (durant l’hiver très froid de 1989, le trou d’ozone a été de 10 à 20 % au nord de la Suède).
Comme l’ozone se reforme au cours de l’année, cet incident a moins de conséquences qu’il n’y paraît au premier abord. Une fois la circulation atmosphérique rétablie, le manque d’ozone se dilue et l’amincissement de la couche d’ozone ne dépasse pas 3 % en moyenne sur toute la planète. Même Si le trou devenait total, avec disparition complète de l’ozone dans le vortex polaire sud à cause d’une grande concentration de CFC, la perte moyenne dans toute l’atmosphère se stabiliserait autour de 6 %. Certes, sous le trou, les UV pleuvraient dru pendant quelques mois par an, mais heureusement, l’Antarctique n’est pas encore très peuplé, même si un livre récent a montré que la population d’Homo scientiae s’y accroît à un rythme soutenu. Comme ceux-ci ne prennent pas de bains de soleil en petite tenue, l’impact du rayonnement sur leur organisme sera limité.
Les dangers encourus par l’humanité dépendent donc de cette contraction de 6 % de la quantité globale d’ozone. 15 % du rayonnement ultraviolet atteindra alors la Terre, au lieu de 13,5 % actuellement, soit une augmentation de 12 %. 1,5 % seulement du rayonnement UV entrant dans l’atmosphère franchira en plus la barrière de l’ozone. Le bouclier ne disparaîtra donc pas, il s’entrouvrira. Quelles en seront les conséquences directes sur la santé humaine, et indirectes sur les plantes et animaux dont nous nous nourrissons? C’est là le véritable enjeu. Si l’homme ne se porte pas plus mal, si les plantes continuent de pousser et de donner un grain aussi épais, on peut oublier le trou d’ozone; sinon, on doit s’inquiéter.
Pour ce qui concerne les plantes, aucun résultat net ne se dégage des expériences. Certaines espèces comme le soja et le riz, sensibles à l’ultraviolet, perdent de leur productivité; d’autres n’y réagissent pas. La sélection de plants résistants ne paraît pas trop difficile et ne ferait que répéter l’histoire de la matière vivante bombardée d’ultraviolets il y a des millions d’années, quand il n’y avait pas d’oxygène, donc pas d’ozone, et que 100 % des UV atteignaient la Terre. En outre, les expériences de laboratoire soumettent les végétaux à des doses plus fortes que l’augmentation maximum possible de 12 %, et négligent l’importance du filtrage par les nuages, autre piège à UV, et du rayonnement transmis par la réverbération des végétaux, elle aussi dépourvue d’UV : le maximum n’est observé que dans des conditions de luminosité pure, dans le désert, et non sous les nuages dans les plantations de riz aux Philippines ou en Thaïlande.
Pour les hommes, les dangers paraissent plus grands, si l’on se fie aux commentaires des grandes institutions. Il faut cependant rester attentif, car le lien entre le constat physique qui vient d’être fait et ses conséquences humaines ne paraît pas toujours fermement établi.
L’Académie des sciences américaine écrit dans son rapport : “Les chercheurs savent que l’exposition directe aux radiations ultraviolettes peut endommager le système immunitaire, entraîner des cataractes et augmenter l’incidence des cancers de la peau. L’Agence fédérale pour la protection de l’environnement estimait en 1986 que l’incidence des cancers de la peau monterait de 2 % pour chaque diminution de 1 % de l’épaisseur de la couche d’ozone. (Aujourd’hui, principalement à cause de modes de vie qui encouragent l’exposition de la peau à la lumière brute du soleil, on compte 300 000 à 400 000 nouveaux cas de cancer de la peau chaque année aux Etats-Unis).” De son côté, le World Resource Institute, écrit dans son dernier rapport :
“Un panel international de scientifiques a affirmé en octobre 1991 qu’au-dessus des Etats-Unis et des autres pays tempérés, environ 3 % de la couche protectrice d’ozone stratosphérique a été perdue. Cette perte d’ozone pourrait permettre une augmentation de 6 % du rayonnement ultraviolet sur Terre, ce qui pourrait accroître de manière significative l’incidence des cancers de la peau – peut-être 12 millions de cas supplémentaires aux Etats-Unis au cours des cinquante prochaines années -, et affecter la production agricole.” Enfin, dans l’édition 1993 de leur State of the World, Lester Brown et le World Watch Institute écrivent que “les épidémiologues de l’Agence fédérale pour la protection de l’environnement estiment que la révision à la hausse du taux de diminution de l’ozone pourrait signifier 200 000 décès supplémentaires par cancer de la peau aux Etats-Unis pour les cinquante ans à venir. A l’échelle du monde entier, cela se traduirait en millions de décès.”
Ces citations montrent la confusion qui règne aussi bien du côté des chiffres que de celui des concepts mesurés. Essayons de clarifier : il faut d’abord distinguer l’incidence et la mortalité. L’incidence, ou nombre de nouveaux cas, compte ceux qui ont été atteints par la maladie au cours de l’année, et le décès ceux qui en sont morts. L’Académie des sciences et le World Resources Institute donnent des chiffres d’incidence, le Worldwatch Institute, les chiffres de décès. Si on adopte l’hypothèse haute d’une diminution de 6 % de l’épaisseur de la couche d’ozone, donc d’une augmentation de 12 % du rayonnement, et si l’on admet aussi que l’augmentation des cas de cancer suit le même rythme, on devrait compter entre 36 000 et 48 000 cas supplémentaires aux Etats-Unis chaque année, pour l’Académie, à comparer aux 240 000 du World Resources Institute.
Quelle proportion des personnes atteintes en mourra ? On ne le sait pas. Seul parmi tous, le Worldwatch Institute avance le chiffre de 4 000 décès supplémentaires aux Etats-Unis chaque année au cours du prochain demi-siècle. En réalité, l’ambiguïté commence en amont avec le terme de cancer : la classification internationale des causes de décès distingue en effet des tumeurs malignes de la peau, les mélanomes, des tumeurs bénignes de la peau (n° 216), des lipomes (autres tumeurs du tissu conjonctif n° 214-215), et des tumeurs de la peau à évolution imprévisible (n° 238.1). Les chances de survie sont très variables selon le type de cancer : moyennes en cas de mélanome, qui donne rapidement des métastases, mais quasiment totales pour les lipomes et surtout pour les tumeurs bénignes de la peau. A titre d’exemple, au cours de la dernière année publiée (1988), on a compté vingt décès pour tumeur bénigne sur tout le territoire américain à comparer aux 2 100 000 décès toutes causes confondues enregistrés cette année-là. En France, deux décès sur 520 000 observés en 1988 ont été imputés à ces tumeurs, et un aux tumeurs à évolution imprévisible. Le chiffre des lipomes est un peu plus élevé (trente-trois décès), mais il comprend surtout des cancers des tissus conjonctifs internes. On ne doit donc pas compter comme un risque sérieux ces tumeurs bénignes, qui se résument le plus souvent à de petites boules dures sous la peau ou à des sortes de verrues que l’on fait extraire pour des raisons esthétiques. Si le péril qui menace l’humanité est de cette taille, on peut être rassuré.
Restent donc seulement en cause les mélanomes dont l’issue est souvent fatale. Eux seuls sont d’ailleurs pris en compte dans les données internationales que rassemble l’IARC, l’agence de l’OMS spécialisée dans l’épidémiologie du cancer. Chaque année, cette agence publie les comptages effectués par des observatoires régionaux de santé, à partir de fichiers de consultations médicales et d’hôpitaux. Ces observatoires couvrent souvent une région limitée et non le pays entier. Les résultats sont cependant très intéressants, comme on le constate sur le tableau suivant :
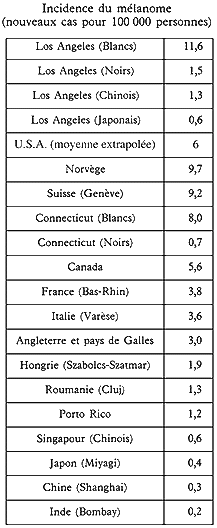
Une extrême diversité apparaît, guidée par deux causes, le niveau de vie et le patrimoine génétique. Entre la Roumanie et la Suisse ou la Norvège, le patrimoine génétique ne change pas beaucoup, mais l’incidence est multipliée par 7. On peut raisonnablement supposer que le bronzage est l’une des causes de cet écart, mais aussi des différences dans l’alimentation. Inversement, lorsqu’on effectue des mesures au même lieu, comme à Los Angeles pour différentes populations, l’échelle des risques varie de 1 à 20, entre les personnes d’origine européenne et celles d’origine asiatique. Avant de discuter plus à fond ces différences, revenons à l’incidence pour les Etats-Unis qui cause tant de soucis aux institutions que nous avons citées plus haut.
Si l’on admet que l’incidence du mélanome aux Etats-Unis (inconnue) est la même qu’au Canada (5,6 pour 100 000 habitants), le nombre de cas annuels serait de 14 000. Si l’on retenait les chiffres extrêmes des Blancs de Los Angeles et de Porto Rico, la fourchette irait de 3 000 à 29 000. Dans tous les cas on est très en deçà du chiffre avancé par l’Académie des sciences (300 000 à 400 000), entre 10 et 100 fois moins. Peut-être y a-t-il eu confusion entre le nombre total des décès par cancer aux États-Unis (485 000 en 1988) et le nombre de personnes atteintes ou décédées du mélanome (entre 1 et 3 % du total des cancers)? Ce sont d’ailleurs les chiffres de décès qui constituent la seule base solide en ce domaine. En l’absence de progrès dans le traitement du mélanome (supposition “naturelle”, mais désespérante, de toutes les institutions quand elles projettent leurs résultats pour les cinquante prochaines années), la mortalité resterait proportionnelle à l’incidence. La connaître permet aussi de contrôler les chiffres d’incidence. Or, il meurt du mélanome environ 6 000 personnes par an aux États-Unis, et 1 000 en France; ces chiffres n’évoluent guère au cours des dix dernières années (très exactement, 834 décès en France en 1988, et 5 979 aux Etats-Unis la même année). Si l’on rapproche ces décès des incidences calculées auparavant, on trouve dans les deux pays un rapport de 1 à 2,5, soit une survie de 60 %, ce qui correspond aux estimations courantes.
Toute la question est maintenant de savoir quelle augmentation du nombre de morts provoquera l’amincissement de la couche d’ozone. Pour cela, il faut d’abord évaluer l’augmentation de rayonnement sur la Terre, puis l’effet cancérigène du rayonnement supplémentaire. Sur le premier point, qui est de nature largement physique, la littérature scientifique avance d’habitude une croissance du rayonnement égale au double du rétrécissement : pour chaque pour-cent en moins de la couche d’ozone, le rayonnement augmente de 2 %. Donc, avec une diminution maximale de 6 % de la couche, on aurait un supplément maximal de rayonnement de 12 %. Conservons ce chiffre, le plus important qui soit avancé.
Quelle est maintenant l’augmentation corrélative des mélanomes ? Une particularité de la courbe d’évolution du mélanome selon l’âge permet d’envisager une réponse : avec le cancer du sein, la leucémie, le cancer du cerveau et la maladie de Hodgkin, c’est le cancer dont le risque s’ accroît le moins avec l’âge. A l’opposé, les risques de cancer de l’estomac, du côlon, du poumon, du foie et du tube digestif augmentent très vite avec l’âge. Ces cancers liés au style de vie (alcoolisme, tabagie, thé brûlant, etc.) résultent pour une bonne part d’un effet de “dose”, c’est-à-dire du cumul des pratiques, tandis que les autres cancers tiennent plus à des hasards de l’environnement et à des susceptibilités génétiques. A la limite, un cancer purement environnemental, sans accumulation des effets de l’exposition, aurait une incidence constante avec l’âge. Pour donner un exemple de ces différences, au Danemark, les taux de mortalité par mélanome passent de 1 pour 10 000 à 30 ans, à 9 pour 10 000 à 70 ans, tandis que pour l’ensemble des tumeurs, les taux passent de 15 pour 10 000 à 30 ans à 970 pour 10 000 à 70 ans. Multiplication par 10 dans un cas, par 60 dans l’autre. Il paraît alors raisonnable de supposer que l’augmentation de l’incidence du mélanome sera égale à l’augmentation du rayonnement. 12 % d’augmentation des UV entraînerait 12 % d’augmentation du risque de mutation défavorable d’une cellule de la peau. D’ailleurs, l’Académie des sciences américaine et l’Agence pour l’environnement ont fait implicitement cette supposition en admettant que l’incidence du cancer de la peau suivrait un rythme deux fois plus rapide que celui de l’amincissement de la couche d’ozone, donc le même rythme d’augmentation que le rayonnement. Le raisonnement précédent ne fait que joindre des attendus à cette estimation, sans doute les mêmes. Il faut cependant ajouter une réserve : on sous-entend que tous les mélanomes sont déclenchés par une seule substance cancérigène, les ultraviolets, ce qui est loin d’être vrai. Admettons-le toutefois comme un facteur aggravant supplémentaire du risque entraîné par l’amincissement de la couche d’ozone.
Nous voici maintenant à pied d’œuvre pour établir une estimation des décès supplémentaires occasionnés par le trou d’ozone : 12 % de 6 000 = 720 aux États-Unis. En France, le tribut à payer serait de 824 x 12 % = 100 décès de plus par an. Aux Indes et en Chine, si l’on extrapole les chiffres d’incidence constatés à Bombay et Shanghai avec un taux de rémission de 50 %, il y aurait aujourd’hui environ 2 000 décès par mélanome, donc, avec les hypothèses précédentes, 240 décès supplémentaires par an à cause du trou d’ozone. On est loin des millions de décès qu’annoncent Lester Brown et le (mal nommé) Worldwatch Institute. N’oublions pas non plus que ces 720 décès américains, ces 100 décès français, ces 240 décès asiatiques sont des valeurs maximales établies sous la supposition d’une diminution maximale (6 %) de la couche d’ozone, d’une imputation de tous les cancers de la peau à l’action du rayonnement ultraviolet et d’une absence de progrès des traitements curatifs au cours des cinquante prochaines années. Si l’on disposait de mesures plus précises, on tomberait peut-être à la moitié, voire au cinquième de ces chiffres, soit respectivement une centaine de décès supplémentaires aux et une dizaine en France.
Il est frappant que la surestimation du risque ait été à ce point importante et générale, car la plupart des auteurs reprennent les trois sources qui ont été citées : pourquoi l’Académie des sciences américaine (et l’Académie de médecine!) avance-t-elle une incidence de 300 à 400 000 cancers de la peau chaque année quand le chiffre tourne autour de 14 000, soit vingt-cinq fois moins? Pourquoi le World Ressources Institute parle-t-il de 240 000 cancers supplémentaires par an en Amérique alors que 12 % des 14 000 cas actuels donne 1 680 cas, soit cent cinquante fois moins? Pourquoi le Worldwatch Institute fixe-t-il le devis à 4 000 décès par an quand le calcul qu’il préconise aboutit à 720 décès? Pourquoi le même institut parle-t-il de millions pour l’ensemble du monde dans les cinquante ans à venir, quand une estimation fondée sur l’incidence actuelle et l’augmentation maximale du rayonnement d’UV donne moins de cent mille? Ce n’est sans doute pas par hasard que l’on confond décès et incidence, que l’on ne parle pas de mélanome, mais de cancers qui peuvent aussi bien être de simples tumeurs bénignes sans risque de décès, que l’on donne les chiffres pour les cinquante ans à venir au lieu de chiffres annuels (qui seraient donc cinquante fois plus faibles) comme si rien ne devait changer dans les méthodes de soin du cancer et de protection des UV. Chacun de ses procédés tend à accroître l’inquiétude en présentant de gros chiffres. S’alarmerait-on si l’on écrivait qu’au grand maximum, le trou de l’ozone peut faire mourir cent Français, deux cents Chinois et sept cents Américains par an? Si l’on disait que le trou d’ozone peut au maximum augmenter la mortalité de trois dix millièmes aux Etats-Unis, de deux dix millièmes en France et de trois cent millièmes en Chine, effraierait-on les populations? Quand on compare ces risques de décès supplémentaires aux ravages de la malaria, de la tuberculose, des dysenteries, quand on sait qu’au moins cent mille morts par an peuvent être imputées au tabac et à l’alcoolisme en France, quand on compte presque à chaque week-end près de cent morts sur les routes françaises, le nombre annuel maximum imputable au trou d’ozone est ramené à sa juste proportion.
Il faut ajouter que si le rayonnement ultraviolet est vraiment la cause du mélanome, on peut gagner plus de vies humaines et plus rapidement en recommandant aux plagistes de porter une petite laine qu’en réduisant le chlore dans le vortex polaire sud. Les écarts selon les lieux et les races laissent en effet deviner que le bronzage n’est sans doute pas innocent dans cette affaire. Les différences de race jouent un rôle, et c’est normal puisqu’on les distingue par leur couleur de peau. Les peaux n’ont pas toutes la même résistance à l’exposition aux UV, les blanches sont les plus fragiles, ensuite les noires puis les jaunes. Mais les différences d’exposition au soleil ont sans doute encore un plus grand rôle que le patrimoine génétique : l’incidence est six fois plus forte chez les Chinois de Los Angeles que chez ceux de Shanghai, elle est huit fois plus forte chez les Blancs de Californie que chez les Roumains de Cluj. Si l’on veut vraiment lutter contre le mélanome, la recette est donc simple : moins s’exposer au soleil. Par exemple, si les Américains retrouvaient le taux d’incidence des Roumains, ils éviteraient chaque année 4 600 des 5 900 cas mortels de mélanome, ce qui est mieux que de supputer sur 720 décès supplémentaires. Ce serait aussi moins coûteux à réaliser que la reconversion des industries du CFC et que les énormes moyens scientifiques mis en œuvre pour guetter toute anomalie de l’ozone. S’il s’agit de sauver des vies humaines ou même précisément de réduire le nombre de cas de mélanomes, il y a certainement mieux à faire que de surveiller le trou d’ozone.
Toute l’affaire illustre une dramatique incapacité à passer des faits naturels et physiques à leurs conséquences humaines. Il n’y a rien à redire sur les mesures du trou d’ozone, sur le calcul des réactions chimiques en jeu, sur les quantités de matière et d’énergie concernées. En revanche, le passage à l’homme est effectué de manière mécanique sans se soucier des flexibilités et des différences sociales et culturelles. Le domaine humain est annexé comme une simple conséquence des faits naturels qui se déroulent sur la planète. Il subit passivement un accident que l’on se propose de soigner par une recette d’ingénieur : un changement du liquide utilisé dans les aérosols, dans les frigidaires et dans les produits de lutte contre les incendies. Du simple point de vue scientifique, on affiche un mépris total pour les données et les méthodes de base des sciences sociales. Le trou d’ozone a tétanisé ceux qui l’étudient ou l’utilisent. Ils ne peuvent pas imaginer autre chose qu’une catastrophe mondiale dont ils seront les sauveurs. Ils collent dessus les premiers chiffres venus, pourvu qu’ils soient gros et menaçants. Dans leurs évaluations des décès ou de l’incidence, ils font preuve d’une légèreté qu’ils ne manqueraient pas de reprocher au moindre opérateur de leur moindre capteur de molécules d’ozone, s’il se conduisait de la sorte. Ce n’est pas volontaire, bien sûr, mais c’est un indice sûr de leur conception mécanique de l’humanité. Ils font comme si la continuité entre la matière physique et l’homme était absolue, comme si elle n’était pas médiatisée par l’environnement physique des humains et leur organisation sociale, comme si, au sein de cet environnement et de cette société, les priorités étaient les mêmes que les leurs.
L’enjeu du trou d’ozone explique peut-être cette étonnante précipitation. Avec lui on a cru tenir une preuve de l’action globale de l’homme sur la planète, et un exemple de son traitement. Spectaculairement, d’ailleurs, les pays développés ont signé à Montréal en 1989 un protocole de réduction de la production des CFC donné comme un exemple aux futures opérations de sauvetage de la planète. Le trou d’ozone a été un immense panneau publicitaire pour montrer les dangers de ce “changement global” et les moyens d’y faire face, car ni le réchauffement supposé d’une planète dont on ne comprend pas encore le fonctionnement climatique, ni la disparition d’espèces dont on ne sait pas si elles sont deux millions ou dix, n’avaient la même matérialité, la même évidence démonstrative. Cela est d’autant plus curieux qu’à part le trou lui-même, l’évidence ne résistait pas à l’analyse.
Tout d’abord, l’affaire est locale, dans les vortex polaires, et non globale. En ces endroits, elle est spectaculaire, mais elle ne change pas grand-chose à la vie des sociétés. L’Antarctique est sans doute le désert le plus inhospitalier du monde, glacial, balayé de vents violents, sec, montagneux et complètement aride. Il peut y atterrir tous les rayonnements UV du ciel, cela ne gênera personne. Ensuite, les preuves formelles des conséquences de ce trou pour la végétation, les animaux et l’homme dans les autres parties du monde font complètement défaut. Quelques expériences de laboratoire dont le protocole ne reproduit pas les conditions réelles, quelques supputations statistiques bâclées, ne remplacent pas le manque complet de preuves. On a certes observé en détail le trou d’ozone, mais on n’a nullement observé ses conséquences. Notamment, rien ne dit qu’en dehors des zones polaires, l’effet des grandes éruptions volcaniques, comme celle d’El Chichon, ou plus récemment celle du Pinatubo, qui ont envoyé dans la stratosphère l’équivalent de la production annuelle d’acide sulfurique américain n’ont pas eu plus d’influence dans les régions tempérées que la dissipation des vortex polaires. Enfin, du point de vue de la population, l’existence du trou ne prouve rien. Il ne fournit pas un indice d’une activité “globale” de l’homme. Au moment où le trou apparaît en 1975, il ne se passe par exemple rien de particulier du point de vue démographique. Il vaudrait mieux chercher du côté de la production de CFC : une statistique confectionnée par le World Resources Institute montre par exemple que, sur 580 000 tonnes de CFC produites dans le monde en 1989, 460000, soit 80 %, l’ont été dans les pays développés (CEE, Amérique du Nord, URSS et Japon), à destination des habitants des mêmes pays, soit un cinquième de la planète. Un habitant moyen des pays développés contribue donc seize fois plus à l’accumulation du CFC qu’un habitant du tiers-monde. La responsabilité “globale” de l’humanité permet aussi de dissimuler des responsabilités locales.
Hervé Le Bras
“Les limites de la planète”
Col. Champs – Ed. Flammarion







